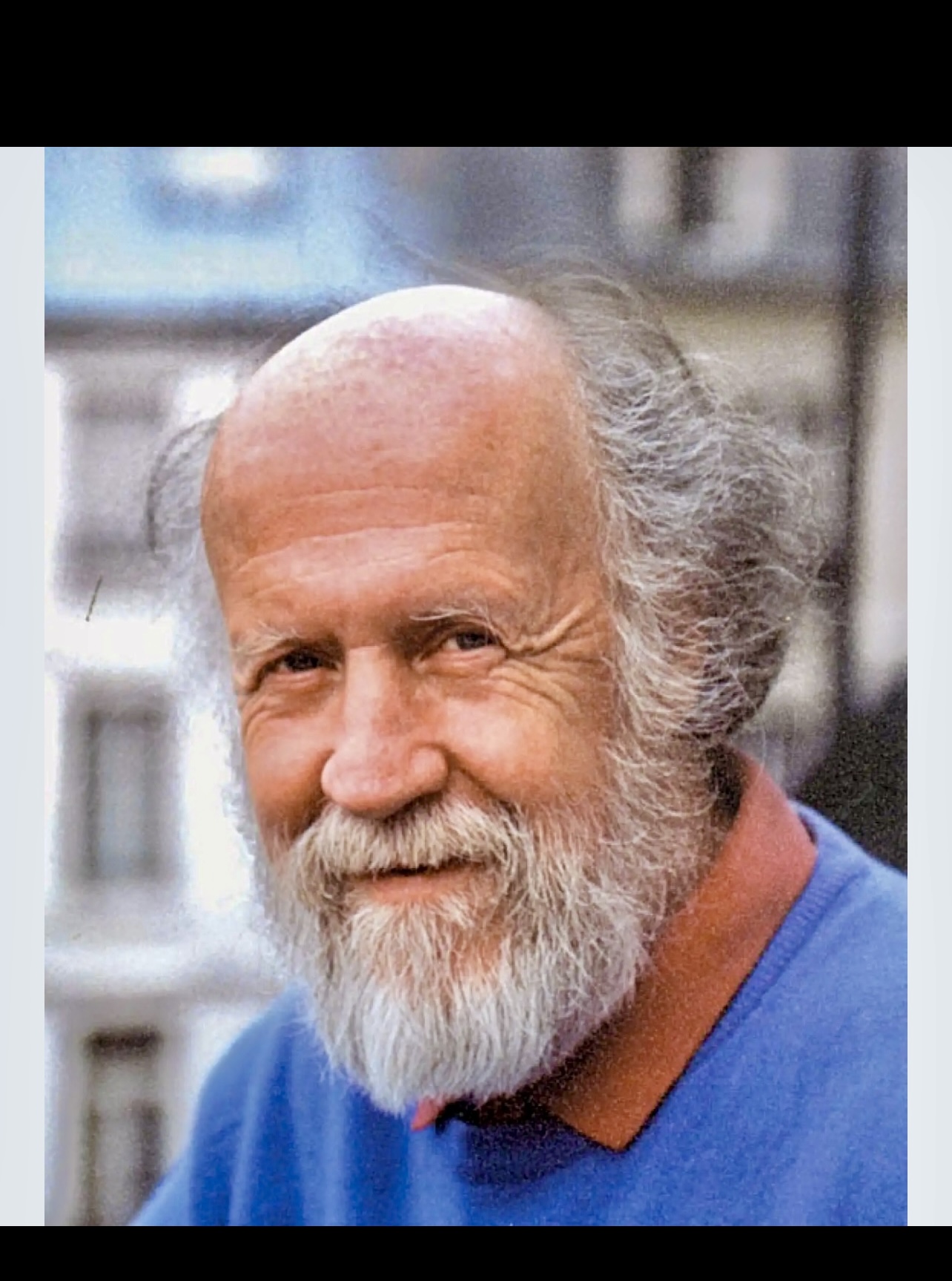Le cinéma intimiste, sobre, subtil et tout en délicatesse de la réalisatrice marocaine, Maryam Touzani. Par Laurent Beurdeley
Maryam Touzani a un parcours singulier. Née d’un père rifain (du Rif, une région montagneuse située dans le nord du Maroc) et d’une mère tangéroise d’origine andalouse, elle vit le jour en 1980 dans la cité du Détroit. Après des études de journalisme à Londres, elle rejoint son pays natal pour y travailler comme critique de cinéma à l’International Film Guide. Si elle ne pensait pas un jour se retrouver derrière l’œil de la caméra, elle réalisa, prolongement naturel de son activité journalistique, un documentaire sur la première « Journée nationale de la femme marocaine » en 2008 et passa ensuite à la fiction avec un premier court, « Quand ils dorment » (2011) qui fut présenté, entre autres, en 2013 au Festival Cinéma d’Afrique d’Angers et au Festival national du film de Tanger où il décrocha le prix du scénario (une création qui rend hommage à son père décédé quelque temps auparavant et auquel elle était très attachée, qui lui permit de faire son deuil et marqua également le début de sa carrière dans le 7e art).
Puis elle enchaîna quelques années plus tard, en 2015, avec un second court, « Aya va la plage », histoire d’une petite bonne de dix ans recluse chez son employeur (malicieuse et intelligente, Aya, ne renonce pas à ses rêves et fait preuve d’audace pendant la fête islamique de l’Aïd vis-à-vis de sa voisine confinée également chez elle). Deux œuvres où la réalisatrice dénonce avec subtilité l’oppression dont font l’objet les femmes quel que soit leur âge.
En 2008, elle rencontra, lors d’une interview, Nabyl Ayouch, un réalisateur dont la notoriété avait depuis longtemps franchi les frontières du royaume. Elle connaissait déjà le travail du cinéaste. Étudiante à Madrid, elle avait été bouleversée par « Ali Zaoua, prince de la rue ». « J’avais l’impression qu’il y avait tout un Maroc que je ne connaissais pas et qui m’échappait[1] » dit-elle, avouant qu’elle ignorait tout de ce cinéma engagé marocain et qu’à l’époque elle n’avait pas retenu le nom du réalisateur avec qui elle partage désormais sa vie tout en collaborant activement à la construction de ses films. Ainsi, Maryam s’est particulièrement investie dans « Much Loved » (lors du casting ainsi que durant le tournage) ; ce long métrage projeté lors de l’édition 2015 du Festival de Cannes, à la Quinzaine des réalisateurs, abordait le quotidien de quatre prostituées à Marrakech, soit dans un pays où l’on n’a pas l’habitude de montrer l’amour tarifé d’une manière aussi frontale et radicale avec l’exploitation éhontée de ces femmes dans des soirées sordides. Interdit de distribution dans les salles obscures du Maroc (au motif qu’il comportait « un outrage grave aux valeurs morales et à la femme marocaine et une atteinte flagrante à l’image du royaume »), le film suscita une virulente polémique.
L’actrice principale, Loubna Abidar (qui pour sa remarquable interprétation obtint le César de la meilleure actrice en 2016) fut menacée de mort. Agressée quelque temps plus tard à la gare de Casablanca, elle dut trouver refuge en France. Le cinéaste, jusqu’ici très apprécié, fut largement vilipendé dans la presse du royaume jusqu’à ses pairs du 7e art qui le dénigrèrent. Mais le plus violent et assurément le plus déstabilisant furent l’ampleur de la vindicte populaire qui confina à l’hystérie autour de cette œuvre (jusqu’à des appels au meurtre du réalisateur sur Facebook). Une franche non négligeable de Marocains s’offusqua de ce regard porté sur leur société par l’un des leurs. Maryam Touzani avait également réalisé quelque temps auparavant en 2014, un documentaire sur un sujet quelque peu similaire, intitulé « Sous ma vieille peau », qui relatait le rapport de plusieurs prostituées plus toutes jeunes à leurs corps vieillissants (elles y témoignaient à visage découvert de leurs conditions). Après la vive controverse autour de « Much Loved », la réalisatrice préféra judicieusement renoncer à sa diffusion afin d’éviter de trop exposer ces femmes et d’attiser la haine incompréhensible autour d’elles[2].
Ce fut une période très difficile à vivre pour le couple. Nabyl Ayouch, fils d’un père musulman marocain et d’une mère juive tunisienne devenue française, qui est né et a vécu à Sarcelles en banlieue parisienne, ne chercha pas à quitter Casablanca où il s’est installé depuis de nombreuses années et où il avait tant donné à travers sa société de production « Ali’n » qui aide les jeunes cinéastes à se lancer. Trois ans plus tard, en mars 2018, il indiquait qu’il était encore conspué sur les réseaux sociaux et lors du tournage de « Razzia », il confia que des décors tombèrent subitement et que des employés se désistaient au dernier moment[3] . Avec son dernier long métrage, « Haut et fort [4]», co-écrit avec Maryam Touzani et première œuvre de fiction d’un cinéaste marocain (depuis « Âmes et Rythmes » d’Abdelaziz Ramadi en 1962) retenue dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 2022, la situation s’apaisa.
C’est dans « Razzia » (2018) que Maryam Touzani coscénarisa avec Nabyl Ayouch, qu’elle apparut également pour la toute première fois face à la caméra. Dans ce récit choral (portrait de quatre personnages aux trajectoires et destins différents qui ont en commun d’avoir à cœur de défendre bec et ongles leurs espaces de liberté), elle campe Salima, une femme mariée qui cherche à s’émanciper de son mari, un homme aisé et conservateur qui la réduit à l’état de trophée. Elle ne supporte plus que ce dernier puisse contrôler ses moindres faits et gestes. C’est une autre femme, Yto, qui va l’aider à se libérer de sa cage dorée. « Il y a beaucoup de moi dans Salima et il y a beaucoup de Salima en moi[5] » avance l’interprète. Dans une scène, Salima, qui porte une jupe courte et moulante, est interpellée dans la rue par un homme qui lui reproche sa féminité qu’il juge provocante, elle poursuit alors son chemin sans mot dire. Quelques instants après avoir tourné cette séquence (lors d’une pause pour aller prendre un café) Maryam vêtue d’une façon presque identique à son personnage (c’était en hiver, sa jupe allait néanmoins jusqu’aux genoux) fut apostrophée par un passant qui lui demanda d’aller se rhabiller. MyriamTouzani confessa lui avoir répliqué sèchement et droit dans les yeux[6], reconnaissant que toutes les femmes marocaines ne disposent pas de la possibilité d’agir ainsi et s’enferment le plus souvent dans la résignation.
Une étude citée par Leïla Slimani révèle au Maroc que les femmes habillées à l’européenne subiraient deux fois plus d’agression à caractère sexuel que celles qui sont voilées. En 2015, le Maroc avait défrayé la chronique lorsque deux jeunes femmes de 23 et 24 ans qui effectuaient des achats dans le souk d’Inezgane furent poursuivies pour attentat à la pudeur devant le tribunal de la ville pour le port d’une jupe considérée comme trop courte (une affaire identique avait également soulevé un tollé en Algérie[7]). Un large mouvement populaire appuyé par une pétition internationale (« Mettre une robe n’est pas un crime ») recueillit des milliers de signatures et ne fut probablement pas étranger au fait que le parquet ait finalement décidé d’abandonner les poursuites.
Dans une entrevue, la réalisatrice soulignait la régression des libertés pour les femmes dans l’espace public. Il y a encore quelques années, affirme-t-elle, elle avait la latitude de pouvoir se baigner sur la plage publique en bas de son domicile en maillot deux pièces sans réfléchir. Maintenant elle avoue que c’est devenu bien plus compliqué et qu’elle ne voit autour d’elle que des femmes en niqab, qui se baignent entièrement habillées[8]. Un retour en arrière qu’elle explique par la diffusion et la prégnance de l’islam wahhabite (rigoriste), éloigné de l’islam malékite (dominant au Maroc) qui est source de tolérance. Au cinéma, comme dans la vraie vie, Myriam refuse avec courage et aplomb que quiconque puisse lui dicter ses agissements. Dans une autre séquence de « Razzia », Salima se rend sur la tombe de son père et s’assoit sur sa sépulture provoquant le courroux d’un religieux. À ce propos, Maryam Touzani indique qu’elle a elle-même adopté un comportement similaire sur la sépulture de son propre père et des hommes sont venus lui dire : « levez-vous, vous n’avez pas le droit ! ». Mais personne n’a le droit de m’obliger à me relever d’une tombe au nom de la religion rétorqua alors la réalisatrice[9], qui ne céda aucunement à cette injonction.
Coïncidence troublante durant ce tournage où son personnage a l’intention d’avorter (Salima se fait masser à cette fin pour finalement y renoncer), elle apprend qu’elle est elle-même enceinte de son premier enfant. « C’était très intense à vivre, et puis ce mélange de fiction et de réalité a donné une vérité encore plus grande à l’expérience d’interpréter Salima[10] » confia-t-elle. Après cette expérience et les succès incontestables de ses courts métrages, il n’est guère étonnant que Maryam Touzani ait décidé de passer à la réalisation d’un long métrage avec les encouragements de Nabyl Ayouch qui l’a toujours incité à « suivre son instinct[11] » et à raconter ses propres histoires.
Ce que recherche avant tout la réalisatrice c’est filmer l’intime en réduisant les dialogues et en faisant passer l’émotion essentiellement à travers les jeux de regards[12]. Dans sa filmographie souvent silencieuse et pétrie de non-dits, ce sont les visages et les yeux, objet de multiples plans rapprochés, qui sont bavards. Le rythme de ses deux films est lent, mais jamais monotone. Quant à la mise en scène, elle est dépouillée de tout artifice ; c’est un cinéma de l’épure. Des histoires simples, des scénarios minimalistes, des sujets de sociétés emplis d’humanité qui sont ancrés dans le local, mais qui touchent à l’universel. Ce sont des drames tout en retenue, d’une grande pudeur, où la douceur domine et qui sont dépourvus de tout jugement moral. Ces narrations évoluent dans des espaces clos (une boutique ou un atelier, le domicile des protagonistes, le hammam, les ruelles de la médina) ; c’est l’âme des personnages qui est scrutée.
La réalisatrice peint avec subtilité les affres de la condition féminine dans « Adam » son premier long métrage (deux femmes marginalisées, l’une veuve, qui ne survit que pour élever sa fille tandis que la seconde, célibataire, porte un enfant qu’elle entend confier à l’adoption). Audacieuse, la cinéaste, dans son second long métrage, « Le Bleu du caftan », aborde les multiples facettes de l’amour et suggère des relations intimes qui ne se réduisent pas à un cadre hétérosexuel en portant à l’écran la naissance d’un triangle amoureux où éclot un désir homosexuel longtemps refoulé ; chaque membre du trio parvenant à transcender ses peurs et appréhensions. Touzani donne aussi à voir des femmes qui tentent de se protéger de la pression sociale dans une société où la culture patriarcale, imbibée d’un conservatisme religieux, circonscrit étroitement leurs libertés quand elle ne les annihile pas. Son approche discrète et feutrée est dénuée de tout manichéisme et se situe aux antipodes d’un militantisme exacerbé. La cinéaste n’est en effet le porte-drapeau d’aucune cause, elle ne cherche pas à bousculer l’ordre établi, mais à sensibiliser, à susciter des débats sur les injustices et les souffrances intimes qu’elles génèrent, contribuant ainsi à faire bouger les lignes. Elle livre des œuvres bouleversantes qui ne sombrent jamais dans le mélodrame et regorgent de sensualité.
Ces deux longs métrages sont empreints de délicatesse, les personnages parvenant peu à peu à s’extirper de leur coquille et à se métamorphoser en dépit d’un contexte où la norme sociale est bien peu tolérante à leur égard. La lumière joue ici un rôle primordial, elle accompagne la transformation des protagonistes et devient plus claire au fur et à mesure que les relations entre eux se tissent. La chef opératrice, Virginie Surdej (Magritte de la meilleure photographie en 2018 pour son travail sur « Une famille syrienne » de Philippe Van Leeuw) qui avait précédemment collaboré sur les plateaux de plusieurs films de Nabyl Ayouch, apprécie particulièrement de travailler sur des films à la frontière entre la fiction et le réel (c’est-à-dire qui consiste à filmer le plus souvent le réel et parfois à construire une réalité). Lorsque d’aucuns firent remarquer que les scènes souvent plongées dans un contraste clair-obscur évoquent la peinture flamande (Vermeer) ou encore Georges de la Tour et Caravage, Touzani indiqua qu’elle a probablement inconsciemment puisé dans cette iconographie tout en précisant que sa vision du cinéma est bien plus influencée par la littérature, en l’occurrence Zola, Dostoïevski, mais sans s’y référer directement. L’habillage sonore est également soigné avec les cris récurrents des mouettes et les divers bruits du quotidien dans la médina, lesquels donnent une qualité réaliste presque documentaire aux deux longs métrages.
La cinéaste s’immisce dans des milieux modestes et fait la part belle à la beauté du travail artisanal (partie intégrante du patrimoine culturel marocain), au travail soigné où l’on prend le temps de peaufiner ses créations. Sa caméra valorise les costumes faits main ou encore la confection de pâtisseries traditionnelles, qui font saliver, avec des plans serrés sur les mains couvertes de farine qui s’activent à pétrir la pâte (« Adam »). Elle montre également des mains qui caressent et laissent couler entre leurs doigts les tissus soyeux avec révérence sans jamais les brusquer, ou brodent des tuniques (« Le Bleu du caftan »). La transmission de ce savoir-faire ancestral auquel elle rend un vibrant hommage qui peut être culinaire (« Adam ») ou vestimentaire (« Le Bleu du caftan ») est de plus en plus menacée par une modernité qui exige vitesse d’exécution et rationalité économique. On relève beaucoup de sensualité dans le toucher des matières et dans les regards. La cinéaste a à cœur de magnifier cette gestuelle artisanale, elle « véhicule tellement de choses sur nous, notre passé, nos racines[13] » dit-elle, attirant également notre attention sur le fait qu’il y a ainsi des traditions qui méritent d’être sublimées tandis que d’autres doivent être sérieusement questionnées dès lors qu’elles sont étouffantes, qu’elles s’avèrent un frein ou un empêchement à ce que l’on veut être et ainsi d’accéder au bonheur (tels le sort des filles-mères et de leur enfant, ostracisés dans « Adam » ou encore tous les non-dits autour des amours masculins voués à demeurer dans l’ombre dans « Le Bleu du Caftan »).
Des récits originaux à l’écriture singulière qui s’inscrivent dans la veine sociale et engagée des films du réalisateur Nabyl Ayouch. Ce dernier n’a eu de cesse, à travers une riche et dense filmographie, de mettre la lumière sur des franges de la population que l’on préfère invisibiliser (les laissés pour compte, les exclus) explorant à chaque fois un microcosme social bien défini tout en ayant soin de s’y immerger préalablement afin de mieux le décortiquer et ainsi d’approcher la vérité : l’univers des enfants des rues dans « Ali Zaoua, prince de la rue[14] » (où il évite judicieusement de sombrer dans le misérabilisme, en donnant la forme d’un conte à son récit) ; les jeunes abandonnés et sans avenir du bidonville de Sidi Moumen, manipulés pour devenir les bras armés de l’extrémisme religieux (« Les Chevaux de Dieu[15] ») ; le milieu de la prostitution féminine (« Much Loved ») ; les minorités étouffées dans « Razzia » (avec une classification qui fut interdite au moins de 16 ans au Maroc que le cinéaste déclara être incapable d’expliquer…..).
Si la place des femmes marocaines est encore faible derrière la caméra (elles réalisent moins de 10% des films, un constat qui n’est d’ailleurs pas propre au Maroc, on manque en général de regard féminin[16]) Maryam Touzani explique qu’elle n’a pas eu moins de possibilités de faire un film et d’obtenir des financements parce qu’elle est une femme. D’ailleurs plusieurs réalisatrices se font remarquer dont Sofia Alaoui, César du meilleur court métrage en 2021 avec « Qu’importe si les bêtes meurent » (récit d’une invasion d’extraterrestres à Imilchil, un village dans l’Atlas) puis avec son premier long métrage, « Animalia » en 2023 qui porte à l’écran un univers fantastique et de science-fiction[17] (ce qui est plutôt inédit) ; Yasmine Benkiran (« Reines[18] ») ; Zineb Wakrim ( « Ayyur » : lune en langue amazigh), un court métrage qui reçut le prix du public Cinef ; Asmae El Moudir, prix de la mise en scène, Un certain regard, pour « Kadib Abyad » (la mère de tous les mensonges).
En 2023, Myriam Touzani fut la première cinéaste du royaume à rejoindre le jury de la sélection officielle du Festival de Cannes ; depuis la création de cette manifestation, seulement deux autres réalisateurs maghrébins furent membres du jury du Festival (le Tunisien Farid Boughedir et l’Algérien Rachid Bouchareb[19] ). En général, la majorité des grands cinéastes arabes sont absents des jurys à Cannes. Touzani est incontestablement une artiste avec qui il va falloir compter dans le paysage cinématographique mondial.
« Adam » : un trio féminin intergénérationnel, entre naissance et renaissance »
« Peu de choses appartiennent aux femmes[20] »
L’intrigue principale est construite autour du portrait très intimiste de deux femmes qui évoluent toutes les deux dans une précarité économique. L’une, Alba, veuve depuis plusieurs années, vivote avec sa fillette en confectionnant des pâtisseries. Quant à Samia, célibataire, elle est enceinte et le terme de sa grossesse ne saurait tarder. Deux trajectoires de vie bien différentes qui ne peuvent apparemment que les éloigner l’une de l’autre et ceci d’autant qu’elles ne sont pas non plus de la même génération. Le destin les a néanmoins réunis, favorisé par la ravissante et espiègle Warda (Douae Belkaouda), la fille de huit ans d’Alba qui n’est pas sans rappeler Aya, la petite bonne, dans le second court métrage de la réalisatrice (« Aya va à la plage »).
Les premières images montrent Samia (campée par Nisrin Erradi[21] qui incarna également en 2022 une mère célibataire dans « Reines », premier long métrage de Yasmine Benkiran[22]) déambulant dans les ruelles de la médina de Casablanca en traînant un lourd bagage. Elle est à la recherche d’un emploi et surtout d’un abri. Samia n’erre pas par hasard, si elle a quitté son village natal, c’est pour mettre au monde en toute discrétion l’enfant qu’elle portait jusqu’ici en cachette à sa famille avec la ferme intention de l’abandonner ensuite en catimini. Dans sa quête d’un toit, lorsqu’elle propose ses services comme employée de maison aux uns et aux autres, toutes les portes se referment systématiquement sur son ventre rond. Il ne lui reste d’autres alternatives que de passer la nuit dans la rue recroquevillée dans un coin. C’est avec beaucoup de réticence et d’hésitations qu’elle est finalement hébergée par Alba qui ne veut pas s’attirer d’ennuis, mais qui cède à sa fillette, laquelle dénuée des préjugés des adultes fait montre de compassion devant le sort de Samia.
Les deux principaux protagonistes évoluent dans un huis clos qui n’est jamais étouffant, mais parsemé de moments de respiration. La mise en scène donne aussi à voir sur l’extérieur, même si c’est avec une indiscutable parcimonie. L’échoppe d’Alba est ouverte sur les venelles de la médina, un lieu grouillant de vie, de bruits divers avec les allées et venues des badauds ; y déambulent de jeunes femmes voilées ou les cheveux au vent. On y rencontre des personnages pittoresques qui exercent des petits métiers traditionnels qui ne sont aucunement une vision folklorique, mais qui ont toujours cours à l’instar du vendeur d’eau ou encore du vendeur de parfums à la sauvette. Il y aussi toutes les scènes du quotidien avec les femmes transportant un plateau de pain ou de pâtisserie au-dessus de leur tête lequel est destiné à la cuisson au four public. L’instantané également d’une vieille femme qui fume et dont le visage strié de rides (en gros plan) avec un tatouage sur le front (une coutume chez les Berbères, chaque dessin ayant une signification[23]) s’apparente à un parchemin, véritable archive d’un long parcours de vie. Il y aussi tous ces moments de liesse pendant la fête de l’Aïd al-Adha[24], avec la présence de musiciens affables et rieurs et une séquence drolatique où deux femmes se chamaillent à propos de la possession d’un mouton.
C’est aussi le brouhaha autour des taxis ou des bus où est clamée la destination et où chacun se presse. Jamais la cinéaste ne montre la moindre agressivité dans toute cette agitation. Mais si la médina palpite d’allégresse, c’est aussi un petit monde circonscrit où chacun se déplace sous le regard souvent très pesant du voisinage ; l’intimité est ainsi forcément parfois bien difficile à préserver. Ainsi Samia est présentée par Alba comme sa cousine de Meknès afin d’éviter que ne courent les commérages. La réalisatrice fit le choix subtil de ne pas s’apitoyer sur le sort de Samia. Ainsi on ignore les circonstances de la grossesse de la jeune femme (celle-ci pourrait être le fruit d’un viol ou de rapports sexuels librement consentis avec un géniteur qui par lâcheté a fui ses promesses d’union et ses responsabilités paternelles). On ne sait pas non plus si Samia a cherché à avorter clandestinement, sachant que cette pratique constitue un délit passible de six mois à deux ans d’emprisonnement pour une femme y ayant recours intentionnellement[25] (selon l’AMLAC[26], entre 600 et 800 avortements seraient pratiqués chaque jour dans le plus grand secret). En portant un enfant conçu hors du cadre sacré du lien matrimonial, Samia s’expose a de sérieuses difficultés ; « c’est la pire chose qui puisse arriver à une femme » souligne pertinemment Maryam Touzani. Une fille-mère est moralement rejetée et honnie par le milieu familial, perçue systématiquement comme une dévergondée, une prostituée. Juridiquement, elle s’expose à des sanctions puisque les relations hors mariage tombent sous le coup du code pénal (article 490) et sont ainsi passibles d’un emprisonnement de six mois à trois ans[27] . Si cette disposition n’est pas systématiquement appliquée, une simple dénonciation peut néanmoins conduire à la prison. Or cette situation confine à l’absurde puisque les relations sexuelles hors mariage sont monnaie courante au Maroc comme dans tous les pays du monde (les jeunes n’attendent pas le mariage pour vivre leur sexualité et ils ne fréquentent pas que les prostituées). Tout aussi dramatique est le devenir de « l’enfant du péché » que l’on appelle « Ould el Haram » (bâtard) ou enfant de la Zina (débauche).
Garder ainsi son enfant en dépit de la réprobation sociale et de la stigmatisation est impensable pour Samia (la donne serait sûrement bien différente dans une famille bourgeoise occidentalisée ; c’est d’ailleurs la situation de Sofia dans le film éponyme de Meryem Benm’Bareck en 2018, où une jeune femme d’un milieu populaire, en déni de grossesse, est épaulée par sa cousine et sa mère qui sont issues d’une autre classe sociale, bien plus éduquée et aisée ; un arrangement est finalement mis en place pour tirer Sofia de ce mauvais pas). Ici, la future mère sait pertinemment que « l’enfant sera exclu toute sa vie ; il sera un moins que rien » dit-elle (si depuis 2002, la loi sur l’état civil permet à la mère célibataire munie de son extrait d’acte de naissance de faire inscrire son enfant sur son propre livret de famille où on lui attribue un patronyme ; cette inscription n’ouvre cependant pas à ce dernier tous les droits économiques et sociaux[28]).
En abandonnant sa progéniture (un phénomène social qui prend de l’ampleur ; selon l’association Insaf, 50 000 enfants chaque année naissent hors mariage[29] et 70 enfants seraient ainsi délaissés par jour[30]) Samia se sauve du déshonneur et peut ainsi retourner au village fonder une famille. Aux antipodes d’une dénonciation réquisitoire, la réalisatrice ne force pas le trait. Avec une rare subtilité, elle attire notre attention sur le douloureux dilemme dans lequel se retrouvent ces femmes entre le désir que leur enfant demeure à leurs côtés tout en subissant la foudre sociale et celui de recouvrer un avenir marital et sociétal en le délaissant. Cette thématique des mères célibataires, qui n’est d’ailleurs plus un tabou dans le royaume, fait l’objet ces dernières années de multiples reportages et essais. Plusieurs associations furent créées afin de prendre en charge ces jeunes mères et leurs enfants en leur fournissant un hébergement, voire un emploi dont l’association « Solidarité féminine » fondée en 1985 par Aïcha Ech Chenna (disparue en septembre 2022, cette courageuse militante très populaire au Maroc et d’ailleurs très médiatisée consacra toute son existence à lutter pour le droit des femmes et l’aide aux mères célibataires afin qu’elles puissent élever leur enfant dans des conditions acceptables ; elle mérite le prix Nobel de la paix déclarait en 2014, dans une interview au quotidien Le Monde, JMG Le Cléziot[31] (prix Nobel de Littérature 2008).
Samia a une personnalité attachante, si elle est incontestablement accablée par sa situation, elle n’est cependant aucunement abattue. D’un tempérament enjoué, elle est habitée par une joie de vivre qu’attestent ses larges sourires ainsi que ses jeux et facéties divers avec Warda (pinces à linge aux oreilles …) qui est pleinement ravie par sa démarche clownesque. C’est une complicité baignée de tendresse. Samia cherche à embellir, agrémenter la fadeur de ses journées. Quant à Alba, revêche et austère, son visage est fermé et triste. C’est une femme anéantie et éteinte, plongée dans un morne ennui qui vit comme une recluse depuis le décès de son époux. Son quotidien est rythmé par son activité de confection de pâtisserie (qui lui assure une maigre subsistance) et l’éducation de sa fille de huit ans, aussi impétueuse que malicieuse. C’est une existence dépourvue de toute fantaisie (l’arrivée de Samia dans son foyer va progressivement contribuer à la faire renaître). Alba offre un toit à la future mère à contrecœur, « juste pour une nuit » précise-t-elle sur un ton bien peu chaleureux. Alba a été heureuse avec son époux, mais depuis sa tragique disparition, elle s’est repliée sur elle-même, n’exprimant aucun sentiment (une façon certainement aussi de se protéger) ; elle ne parvient pas à faire son deuil tant elle est noyée dans la nostalgie du passé. Si on suppose que la période d’abstinence sexuelle dictée par l’islam (de 4 mois et 10 jours) est achevée depuis longtemps, Alba ne veut néanmoins pas d’un autre homme dans sa vie.
Le rideau de son échoppe qu’elle referme à maintes reprises dans le récit est une belle métaphore de son état d’esprit, de son isolement, de sa solitude, d’un horizon qui paraît irrémédiablement clos. Son conjoint qui était pêcheur a péri en mer ; cette brusque perte fut d’autant plus douloureuse et incommensurable que « la mort n’appartient pas aux femmes » déplore la veuve amèrement. La tradition veut en effet que les épouses, mères, sœurs, filles n’assistent pas à la cérémonie d’inhumation. Alba fut ainsi écartée de l’ultime adieu lors de l’ensevelissement de son conjoint ; « c’est un viol d’intimité avec la personne qui décède » relève Maryam Touzani[32]. La place des femmes durant le deuil ainsi que les rituels funéraires étaient abordés dans « Quand ils dorment », le premier court métrage de la réalisatrice (Sarah, une fillette de huit ans, entretenait une relation très forte avec son grand-père. Lorsque le vieil homme meurt, son corps demeure toute la nuit à la maison en attente de sépulture. En dépit des conventions religieuses, Sarah, bien déterminée à revoir son grand-père dans la pièce où il repose, parviendra à passer la nuit en se blottissant à ses côtés). L’interdiction de la participation des femmes aux funérailles est sujette à controverse. La vulgate coranique est silencieuse sur ce point. L’exclusion des femmes repose ainsi sur un hadith non classé comme authentique[33] qui divise les oulémas. Certains d’entre eux affirment que les femmes ont accès aux inhumations. D’aucuns estiment qu’il y a confusion entre tradition et religion et qu’une telle exclusion est discriminatoire.
Singularité de la narration, la présence masculine apparait ici plutôt effacée et affable. Slimani (Aziz Hattab), le soupirant d’Alba est doux et attentionné, rompant ainsi avec le cliché de l’homme arabe souvent présenté comme brutal, machiste et insensible ; il est presque benêt tellement il fait preuve de maladresse dans sa démarche amoureuse vis-à-vis d’Alba. On relève également la bienveillance du boulanger qui tend un tabouret à Samia afin d’éviter que celle-ci ne piétine trop en attendant la cuisson du pain qu’il vient d’enfourner. Et ceci sous les remarques acerbes et particulièrement désobligeantes des autres femmes (qui doivent demeurer debout) : « c’est facile d’aller se faire engrosser dans la rue et qu’on te fasse des gentillesses ».
La mue
Le cœur du récit est le combat tout en douceur de ces deux femmes qui semblent totalement corsetées dans les conventions sociales. Après s’être affrontées dans un premier temps, elles résistent à leur manière, s’apprivoisent pas à pas, s’ouvrent l’une à l’autre et finissent avec le temps par se raconter intimement. Samia est généreuse et donne beaucoup, Alba ne sera pas en reste. Les deux femmes, en s’épaulant, se transforment réciproquement. C’est une poignante leçon de sororité avec la naissance également d’une belle amitié.
Jusqu’à présent la boutique vivotait, Alba ne proposait essentiellement à la clientèle que des galettes de semoule (Harcha) ou les « msemens », c’est-à-dire des crêpes légèrement feuilletées qui sont ici cuites sur une plaque en fonte après avoir été préalablement huilées et plusieurs fois repliée sur elles même. Samia qui trouve peu à peu sa place au sein du foyer apporte une contribution non négligeable au commerce d’Alba avec la confection ancestrale d’une autre pâtisserie, une spécialité locale, la « Rziza », auquel a renoncé Alba parce que cette dernière des lors qu’elle est fabriquée à la main requiert des opérations de fabrication complexes[34] (la cinéaste relate que peu avant le tournage, elle n’était pas parvenue à rencontrer une seule personne préparant la Rziza à la main dans la médina de Casablanca[35]). Samia lui transmet son savoir-faire et les clients affluent. Pour la fête de l’Aïd, les deux femmes proposent également des Fāqūs (petits gâteaux secs aux amandes et aux raisins secs) et les fameuses cornes de gazelle (préparées à base de pâte d’amande parfumée à l’eau de fleur d’oranger).
Indiscutablement la grande force et la beauté du film résident dans la gestuelle des mains filmées au plus près. Dans une scène d’une grande sensualité, non dénuée d’érotisme, les mains en plan rapprochés malaxent la pâte avec une grande énergie, se touchent, se nouent avec volupté. Samia apprend ainsi à Alba à renouer avec ses sens, à travailler la pâte doucement pour ressentir et proscrire l’automatisme précis Myriam Touzani. Samia a d’ailleurs une bonne connaissance de la matière première, qu’elle sait pertinemment évaluer, détectant dans une séquence la mauvaise qualité de la farine. Les deux actrices ont appris à confectionner des pâtisseries avec un coach, ce qui était essentiel selon la cinéaste pour donner de l’authenticité[36]. Ces deux femmes ressemblent à de vraies gens que l’on pourrait rencontrer dans la médina, elles sont naturelles, elles ne sont pas maquillées ; il n’y a pas d’artifice.
Grâce à la persévérance de Samia, Alba consent, après de nombreuses réticences, à prêter l’oreille à une chanson dont elle savourait les paroles et que son mari appréciait également beaucoup, un titre qu’elle se refusait d’écouter depuis le décès de son époux. Elle se déleste peu à peu de son armure et s’éveille à la vie, recouvre sa féminité en renouant avec son corps et ses désirs. De nouveau coquette, elle se maquille les yeux (khôl sur ses paupières), arbore un bandeau de multiples couleurs dans ses cheveux et apparaît avec un visage radieux. Alba vient également à la rescousse de la future mère. Ainsi, lorsque l’enfant vient au monde, Samia ne lui accorde pas le moindre regard, son attitude consiste à se détacher du nourrisson et à ne lui prodiguer aucun geste d’affection ; son souhait est que l’enfant soit hors de sa vue. Elle est ainsi inerte sans réaction, dépourvue d’émotion, figée comme une statue de cire, insensible aux balbutiements de sa progéniture. En fait, elle lutte intérieurement afin de ne pas s’attacher jusqu’à chercher dans un moment de détresse profonde à étouffer contre elle le bébé pour le sauver d’un avenir sombre. Alba vient alors l’épauler dans ces instants délicats. Dans une longue scène magnifique qui est un vibrant hommage à toutes les mères, l’instinct maternel prend finalement le dessus. Samia entre en interaction avec son bébé, l’allaite, caresse son corps de la tête aux pieds, le couvre de baisers, pour s’endormir ensuite à ses côtés. Plus tard, elle lave avec délicatesse le poupon (qui fait l’objet de nombreux gros plans) et parvient à tisser des liens de plus en plus étroits avec le nouveau-né.
L’écriture du scénario s’inspire d’une expérience personnelle de la réalisatrice. De retour dans la demeure familiale à Tanger lorsqu’elle avait vingt-deux ans, après la fin de ses études, ses parents accueillirent une jeune femme, qui était dans la même situation de détresse que Samia, c’est-à-dire enceinte de huit mois et non mariée. Les souvenirs de cette femme demeurèrent une trace indélébile dans sa mémoire d’autant plus qu’elle partagea sa chambre avec elle pendant plusieurs semaines et lorsque son enfant vint au monde, elle accompagna la jeune mère aux services sociaux pour y confier le nourrisson[37]. La réalisatrice indiqua également que c’est durant sa période de grossesse lorsqu’elle attendait son premier enfant (Noam) qu’elle concocta son scénario.
Pour incarner Samia, Touzani songea dans un premier temps à une interprète non professionnelle, à une mère célibataire puis elle se ravisa considérant que les réminiscences pour cette dernière de son douloureux parcours seraient une charge émotive trop lourde à porter. Elle confia finalement cette interprétation à une jeune comédienne, née en 1989, Nisrine Erradi, qui rencontra des mères célibataires afin de se nourrir de leur vécu. Pour son rôle, la comédienne relata également avoir beaucoup observé sa propre sœur qui venait d’accoucher et son bébé, elle l’aida d’ailleurs à s’occuper du poupon[38] ». Quant à Alba, elle est campée par Lubna Azabal (révélation et héroïne tragique dans « Incendies » (2010) du Québécois Denis Villeneuve[39]) qui expliqua avoir insisté auprès de Maryam Touzani pour décrocher le rôle. La réalisatrice entendait à l’origine recruter une comédienne marocaine. Elle n’avait aucunement pensé à Azabal qu’elle connaissait cependant puisque celle-ci avait joué dans l’un des films de Nabyl Ayouch (« Une minute de soleil en moins », 2003). L’actrice belge confessa que pour s’exprimer comme une arabe du cru, elle a dû effectuer un travail avec un coach sur son accent marocain qui était précaire : « Quand je parle on dirait Birkin qui parle français[40] » dit-elle. Ce fut une réappropriation de la langue et des racines pour Lubna (dont le père était Marocain) relève la cinéaste[41]. Si Lubna, qui n’a pas d’enfant, affirme ne pas avoir la fibre maternelle, elle est toutefois sensible à la condition féminine. Lors de ses divers voyages, elle dit avoir vu des femmes devoir se soumettre sous peine de prendre des coups[42].
Adam, le prénom choisi par Samia pour son enfant, est une référence biblique et coranique[43], celle du premier homme créé par Dieu. Et on se plaît à imaginer qu’il sera peut être le premier d’une nouvelle ère au Maroc où un enfant illégitime quel que soit son sexe et sa mère feront l’objet d’un ostracisme moindre et de plus bien plus de bienveillance et de compassion que par le passé. Que ce film puisse contribuer à changer le regard sociétal est probablement l’intention profonde de Touzani. Alba qui ne veut surtout pas que Samia puisse « marchandiser » son rejeton en le confiant à n’importe quelles mains a peut-être également réussi à dissuader la jeune mère de ne pas abandonner son enfant. La cinéaste laisse la porte ouverte sur le devenir de Samia et de son fils.
Le film projeté à Cannes, dans la section Un Certain Regard, glana ensuite une kyrielle de distinctions dans le monde entier. Il s’inscrit au Maroc dans un contexte où les femmes n’ont de cesse de redresser la tête et de lutter contre l’assujettissement de leur corps qui est favorisé par l’existence de lois rétrogrades et liberticides et aussi par une société elle-même encore très conservatrice, bien peu soucieuse du droit des femmes et des libertés individuelles. En 2019, la romancière Leïla Slimani fut à l’origine du manifeste des « 490 » en référence à l’article du Code pénal qui réprime les relations sexuelles hors mariage (publié en septembre dans différents médias du royaume) où les femmes signataires, dénonçant l’hypocrite sociale et la culture du mensonge ambiante, proclamèrent avoir déjà violé les lois obsolètes de leur pays sur les mœurs et l’avortement. Une posture qui faisait également écho à l’affaire Hajar Raissouni (une jeune journaliste de 28 ans condamnée en 2019 à une année de prison pour « avortement illégal et relations sexuelles hors mariage ») qui avait fait couler beaucoup d’encre et avait suscité une vague d’indignation au royaume et à l’étranger[44]) ; elle semble manifestement indiquer que ces législations peuvent être instrumentalisées à des fins de vengeances politiques et personnelles.
« LE BLEU DU CAFTAN » : Quand l’amour transcende les préjugés les plus tenaces
La narration se déroule dans l’une des plus anciennes médinas du Maroc à Salé, une ville religieuse et conservatrice qui est située au bord de l’Atlantique, en face de Rabat, la capitale administrative (le fleuve le Bouregreg séparant les deux cités). La toile de fond du récit est ici l’art pluri séculaire du caftan, une parure arborée par les femmes lors des cérémonies de mariages, ou pour la naissance d’un enfant. La fascination de la réalisatrice pour ce vêtement traditionnel est liée à celui que portait sa mère, qui était ancien, de couleur noire et très travaillée. C’est d’ailleurs paré de ce caftan familial que la cinéaste gravit les marches du Festival de Cannes lors de la présentation de son film dans la section « Un certain regard », en 2022. Le caftan, véritable œuvre d’art qui se transmet de génération en génération, ne saurait être réduit à une simple étoffe, il est bien plus que cela, il possède une âme recélant tout l’investissement de son créateur, mais également toutes les émotions de celle qui l’a revêtu[45] explique Maryam Touzani.
Questionnée sur le choix de la couleur du caftan retenu dans le film, un bleu pétrole (et non pas un bleu roi comme le fait d’ailleurs remarquer le maître tailleur à une cliente dans le récit), la réalisatrice met en avant que ce coloris suscite chez elle un sentiment de liberté et d’horizon infini que l’on retrouve lorsque l’on regarde l’océan et le ciel[46]. Plusieurs mois furent nécessaires pour qu’elle puisse dénicher cette teinte (qui existe dans différentes nuances). C’est sur le marché Saint-Pierre à Paris qu’elle mit finalement la main sur le précieux sésame[47]. On note outre la présence du bleu dominant du caftan toute une palette de couleurs contrastées avec des tons brun clair ou encore ocre (au café, par exemple) ; des couleurs vives pour les diverses étoffes. Incontestablement, ce caftan, fruit d’une commande d’une cliente, confectionné tout au long du récit, est un personnage à part entière dans le film (qui fut tourné en sept semaines). Et son devenir une fois achevé est pour le moins totalement inattendu, contraire à la tradition (ce qui est révélé dans les dernières minutes du film), mais c’est un incontestable témoignage d’amour. L’amour que porte Halim à sa femme qui est parvenue à le libérer de ses peurs et de sa honte.
Halim et Mina forment un couple banal d’âge mûr. Mariés depuis de longues années, mais sans enfant, ils vivent de la confection de caftan. Halim est un artisan-tailleur (un mâalem) avec son maître ruban autour du cou qu’il ne quitte jamais. Cet homme aux yeux doux et arborant une moustache travaille à l’ancienne. Tout est fait manuellement. Il passe des journées entières affairé dans l’arrière-boutique qui tient lieu d’atelier (tel un cocon protégé du monde, loin de toute effervescence) à assembler des broderies et à manier l’aiguille avec une infinie précision et concentration, attentif au moindre détail, animé par un souci de perfection (dans un silence monacal). Sa vie est rythmée par ce quotidien, qu’illustre également le lever récurrent du rideau du magasin chaque matin. Son épouse, Mina, tient la boutique aux multiples tissus chamarrés, qu’elle gère énergétiquement du moins durant les premiers temps. C’est elle qui passe les commandes, font patienter les clientes souvent revêches et exigeantes tout en veillant scrupuleusement à l’acquittement des factures. Halim souhaite perpétuer l’élégance de son art et refuse la mécanisation de son activité qui exige patience, rigueur et endurance ; il incarne une tradition, un art de faire, qui tend à disparaître.
Pièce dominante du couple, Mina a du caractère et ne s’en laisse pas conter lorsque les clientes bourgeoises de l’atelier exigent plus de célérité dans la fabrication de leur caftan. « Mon mari est un mâalem et pas une machine » rétorque-t-elle avec une fermeté mêlée d’une très nette exaspération qui n’est d’ailleurs pas dénuée d’une once de fierté. Extravertie, transgressive, elle n’hésite pas à braver les interdits en décidant de faire fi des conventions. Elle s’attable avec son époux au café (chez Moha), un territoire fréquenté exclusivement par la gent masculine, y fume la pipe et s’enthousiasme bruyamment sans retenue en lançant un hourra lors d’un match de football retransmis à la télévision lorsqu’un but est marqué par l’équipe adverse devant des clients médusés. Une posture qui ne suscite pas la moindre réprobation de son mari (un homme discret, réservé, plutôt taciturne et d’une grande douceur, ne prononçant jamais un mot plus haut que l’autre), mais provoque son hilarité. On est aux antipodes des stéréotypes de la femme soumise et du mari autoritaire arborant une virilité exubérante.
On découvre peu à peu que leurs sentiments après 25 ans de vie commune ne se sont pas vraiment érodés. Leur amour est tendre, sincère et réciproque. Touzani est parvenue à créer un couple parfaitement crédible à l’écran. Il y a tous ces moments de l’existence parsemés de petits bonheurs de la vie quotidienne, des joies simples, les promenades avec les achats et le choix scrupuleux des clémentines sur les étals des marchands ambulants ; un fruit dont la présence est récurrente tout au long du récit. Nina se délecte de la saveur de cet agrume qui dépourvu de pépins est ainsi aisé à éplucher (les clémentines déposées dans la corbeille de la cuisine finissent un jour par se gâter, métaphore de l’état de santé de Mina qui se détériore à grand pas).
Une profonde affection et un grand respect mutuel unissent les deux conjoints. Diligent, Halim multiplie les attentions pour son épouse, surtout lorsque ses forces commencent à l’abandonner ; il veut rester le plus souvent à ses côtés pour s’occuper d’elle et ne se rend plus à l’atelier, l’aide à se dévêtir ou à se vêtir, la relève lorsqu’elle chute, lave ses cheveux pour la première fois (un instant précieux que savoure Mina qui sait ses jours comptés) extirpe la douce et fine membrane des quartiers de clémentines dont elle raffole.
Si la complicité entre les deux époux est manifeste, elle n’est cependant pas physique. Bien que Mina soit entreprenante et initie les débats amoureux avec son mari, celui-ci accomplit sans passion ardente son devoir conjugal. Elle n’est pas à même de satisfaire tous les besoins du mâalem dont le désir charnel est ailleurs. Son inclination porte sur les hommes. Mina n’est sûrement pas vraiment satisfaite sur le plan des rapports intimes, mais elle aime son époux. Elle a toujours compris dès le début de leur relation, c’est d’ailleurs elle qui le demanda en mariage. Mais elle fit le choix de fermer les yeux, de ne rien savoir; ils n’ont jamais abordé ce sujet entre eux. Ils taisent ce secret inavouable dans une société profondément homophobe. La décision de Mina fut de vivre aux côtés de cet homme qu’elle entend protéger, en le choyant, en lui concoctant de bons petits plats savoureux comme une rfissa (un plat qui se compose de poulet, de msemens, de bouillons d’oignons, d’épices, de fenugrec et de lentilles). Elle s’est accommodée de ce mari qui nourrit un désir pour l’autre sexe ; les deux partenaires sont ainsi parvenus à s’aimer différemment. Et pour préserver son couple, elle garde le plus souvent le silence (une attitude dans le jeu qui convenait à Lubna Azabal qui affirme apprécier de jouer les non-dits pour ne pas étouffer le public[48]).
Le mâalem fréquente régulièrement les bains publics. C’est un lieu avec ses murs moites et son caractère hermétique qui évoque une ambiance utérine. Mais il y règne également une atmosphère très sensuelle et c’est dans les vapeurs de cet espace qu’il assouvit ses pulsions sexuelles. Il y fait des rencontres furtives où il étreint d’autres corps à l’abri des regards. Pudique et dans la retenue, la caméra ne dévoile que des plans de pieds et de chevilles derrière la porte d’une cabine close qui suggèrent le passage à l’acte sexuel. La fréquentation récurrente du hammam symbolise également le poids de sa culpabilité. C’est un antre où l’on vient se purifier, se laver du péché ; « l’hygiène est une partie indissociable de la foi, et le hammam est souvent perçu comme l’antichambre de la salle prière[49] ».
La réalisatrice confia que le personnage de Halim est né d’une rencontre fortuite lorsqu’elle était en repérage pour « Adam », son premier long métrage, avec un coiffeur pour dames dans la médina de Casablanca. Au cours de leur conservation, elle décela des non-dits dans sa vie « quelque chose d’étouffé par rapport à ce qu’il était dans son for intérieur et auquel il devait faire face dans une société conservatrice pour continuer à vivre». Touzani estime que c’est quelque chose qui peut être tellement violent par moment, en même temps on peut trouver un semblant de bonheur là-dedans parce que l’on n’a pas le choix[50] ».
Toute la routine du couple va vaciller lorsqu’ils décidèrent de recruter un apprenti pour répondre aux commandes de la clientèle toujours plus pressée et exigeante. La recrue est timide et séduisante avec ses yeux langoureux ; ce jeune homme orphelin qui fut livré à lui-même dès l’âge de huit ans a soif d’apprendre le métier et s’applique à suivre scrupuleusement les conseils du maître. Son arrivée est tout sauf anodine, elle bouscule l’équilibre jusqu’ici harmonieux du couple. Mina n’est pas dupe comme les spectateurs d’ailleurs de l’irrésistible attirance de son mari pour ce jeune ténébreux au charme nonchalant. Il y a constamment entre les deux hommes un ballet de regards gênés, parfois furtifs ou plus appuyés tandis que leurs doigts s’effleurent.
Mina est dans un premier temps déstabilisée de constater que son époux tombe amoureux de l’apprenti. La jalousie prend le dessus donnant lieu à un affrontement avec Youssef qu’elle perçoit comme une menace. Elle le rabroue lorsqu’il dévoile son torse nu afin de revêtir sa tenue de travail. Elle s’emploie également à mettre le jeune apprenti en difficulté en le soupçonnant d’avoir dérobé un tissu de soie rose ; le dénigre auprès de son époux considérant qu’il ne fera pas l’affaire. Mais le maâlem s’applique avec une extrême douceur et beaucoup de doigté à expliquer les gestes et les rudiments du métier. Youssef saisit parfaitement les tourments qui agitent le couple ; il est à l’écoute et se positionne en retrait en prenant soin de ne jamais s’immiscer dans leur duo. Il évite judicieusement de froisser et d’entrer en conflit avec Mina tandis qu’il sait pertinemment que cette dernière a non seulement recouvré le tissu disparu, mais qu’elle n’en dit mot afin de rendre dubitatif son mari. Puis peu à peu Youssef devient une pièce essentielle à la survie du ménage où Mina va l’intégrer pour former un trio atypique.
Touzani explore les tréfonds de l’âme inquiète de Halim qui longtemps résiste avec gravité et dignité en enfouissant les sentiments qu’il éprouve pour Youssef lequel, quant à lui, ne dissimule pas son inclination pour son aîné et finit d’ailleurs par lui déclarer son amour. Mais dans cette scène bouleversante, Halim se refuse au désir de Youssef tout en ne parvenant pas réprimer quelques larmes étouffées, celles d’un amour qu’il juge impossible. Parce qu’il ne veut surtout pas que cela puisse le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Mina. (La culpabilité lui pèse, mais son mal-être n’est à aucun moment exprimé verbalement). Jamais Halim ne s’est épanché sur ses penchants. C’est seulement dans les derniers moments de vie de Mina qu’il révèlera cette blessure qui le hante : « j’ai cherché à l’étouffer » ; il ne voulait surtout pas la salir. Au Maroc, l’homosexualité est condamnée par la vulgate coranique et l’article 489 du Code pénal prévoit un emprisonnement de six mois à trois ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 120 à 1200 dirhams.
Cette orientation sexuelle est souvent connue, mais elle est tue lorsqu’elle demeure confinée dans la discrétion, c’est-à-dire circonscrite à la sphère privée. Non exposée, elle est mieux comprise et finalement un peu mieux acceptée. C’est sa visibilité dans l’espace public ou encore le fait d’afficher et de revendiquer une identité gay qui sont blâmés. C’est éminemment toujours un sujet très sensible au royaume. En 2015, l’hebdomadaire Maroc Hebdo avait titré sa une : « Faut-il brûler les homos ? » et ceci tandis qu’un rapport du ministère de la Santé déclarait qu’il fallait dépénaliser l’homosexualité. Devant la réprobation sur les réseaux sociaux, le directeur de la publication, Mohammed Selhami, avait ensuite retiré de la vente et des sites sur la toile ce numéro en présentant ses excuses à tous les lecteurs qui avaient pu être choqués. Si les poursuites contre les homosexuels ne sont pas systématiques, une dénonciation, ou un flagrant délit d’ébats sexuels peuvent conduire à la prison.
La métamorphose
Mina, longtemps hostile, va s’engager dans un tout autre cheminement, lucide et consciente que son temps est désormais compté, consciente de sa finitude. L’épouse du mâalem est rongée par la maladie (un cancer du sein) qui resurgit après une phase de rémission et qui l’affaiblit peu à peu. Elle a d’ailleurs renoncé à suivre d’autres traitements ou à des soins appropriés sachant pertinemment qu’elle est désormais condamnée. Elle s’est longtemps battue, son choix est dorénavant d’attendre le dénouement : « c’est entre les mains de Dieu » rétorque-t-elle à Halim qui l’incite encore à passer de nouveaux examens. Pour interpréter le rôle de cette femme si forte qui diminue progressivement et dont on découvre le corps décharné et mutilé par l’ablation d’un sein, la réalisatrice pensa à Lubna Azabal, à qui elle envoya le scénario. L’actrice belge (qui aurait aimé devenir journaliste de guerre[51]) tomba amoureuse du personnage et songea pendant la lecture du récit à Frida Khado ; cette artiste mexicaine qui dès l’enfance fut frappée par la poliomyélite puis plus tard fut profondément meurtrie par un grave accident qui affecta sa colonne vertébrale et la cloua au lit (elle souffrit le martyr tout au long de son existence). Pour incarner au mieux son rôle, Lubna Azabal, dont c’est la seconde collaboration avec la réalisatrice, s’attela à suivre un régime hypocalorique avec une nutritionniste pour accompagner son amaigrissement (300 calories par jour durant quelque temps[52]).
Elle perdit ainsi près de huit kilos (jusqu’à descendre à 41 kilos[53]) : « Je n’avais pas envie de jouer la maladie, je voulais que mon corps l’incarne par mon visage, par ma fatigue, je voulais arriver à cet état de minceur que provoque la maladie[54] dit-elle. Elle « souhaitait sentir la mort dans son corps et se sentir partir » ajouta encore la réalisatrice qui n’imposa rien à l’actrice[55]. Lubna précisa que l’année du tournage, elle perdit plusieurs proches dont son meilleur ami (d’un cancer du poumon) et son père (qui décéda le dernier jour du tournage). Elle dit avoir ainsi « vu la progression de la maladie et avoir en tête cette étincelle dans leur regard, ils ne voulaient pas mourir[56] ». La transformation physique de l’actrice pour son rôle nécessita de tourner le plus possible les scènes dans l’ordre chronologique de l’histoire de façon à permettre à son corps d’évoluer tout au long du film[57].
Animée par la préoccupation d’assurer le bonheur de son mari lorsqu’elle sera partie, Mina s’emploie à aider son époux à s’accepter. Déterminée, elle luttera jusqu’aux derniers instants de son existence non pas pour elle-même, mais pour l’après, c’est-à-dire pour le bien-être de Halim qui lui survivra. Et elle fait preuve d’un immense amour, aspirant le meilleur pour lui. Cette femme profondément croyante, qui s’adonne quotidiennement à la prière, parvient à outrepasser ses préjugés et fait preuve d’une indéniable d’ouverture d’esprit en encourageant le mâalem, qui vivait jusqu’ici sa véritable sexualité dans la honte, à s’épanouir : « N’aie pas peur d’aimer » dit-elle dans un dernier souffle.
Se met en place un triangle amoureux qui transcende les tabous, les désirs refoulés, les peurs et la maladie. Mina souffre le plus souvent en silence en laissant parfois échapper quelques cris lorsque la douleur est trop intense. Mais si l’appartement devient de plus en plus sombre, métaphore d’une vie qui se retire peu à peu, la fin de vie de Mina est lumineuse avec l’insertion d’un plan joyeux. Celui où le trio se forme et se cimente véritablement ; ils sont enfin complices. Après un repas qu’ils partagent ensemble pour la première fois, ils se livrent à une chorégraphie sur une musique diffusée en contrebas de la fenêtre grande ouverte de leur appartement sur les ruelles de la médina. Un moment de grâce où le temps semble suspendu avec leurs visages radieux. Un dernier sursaut de vitalité pour Mina qui donne son approbation à l’éclosion de leurs sentiments jusqu’à les inciter par ailleurs à se rendre tous les deux au hammam. « Elle veut offrir à son amour un autre amour » relève la cinéaste[58].
Plusieurs séquences effleurent le climat politique du royaume. L’une montre l’omniprésence policière avec ses contrôles tatillons sur la liberté d’aller et venir, soit une posture menaçante pour les libertés individuelles au quotidien. Ainsi de retour de nuit à leur domicile, un policier inquisiteur exige du couple la présentation de leur pièce d’identité et à défaut de leur acte de mariage. Mina bien plus rebelle que son mari et offusquée lance avec fermeté : « Depuis quand vous contrôlez dans la médina ? ». Dans une autre scène, c’est un mal endémique qui est pointé sous forme humoristique, celui de la corruption, ici des fonctionnaires locaux. Il y a en effet une cliente arrogante et mécontente du délai de confection du caftan qu’elle a commandé, or il se trouve qu’elle est l’épouse du chef de la sûreté et il est connu qu’elle honore le montant de ses factures avec les pots de vin de son mari ; une situation qui est ici tournée en dérision par le couple d’artisans.
Interpréter au cinéma des personnes mues par une attirance homosexuelle en terre musulmane relève d’une certaine bravoure ; le plus souvent les acteurs issus de la région refusent d’incarner ces rôles. Ceci est d’autant plus courageux de la part d’Ayoub Missioui qui joue ici son premier rôle devant la caméra. Pour camper au mieux son personnage, l’acteur indiqua avoir effectué un stage de plusieurs semaines chez un mâalem afin de découvrir le processus de fabrication d’un caftan, les techniques de couture. Il était primordial pour la réalisatrice que son jeu ne soit pas mécanique et que le spectateur ne perçoive pas qu’il manipulait du tissu pour la première fois. Quant à Halim, il est incarné par l’acteur palestinien Saleh Bakri (remarquable dans « La visite de la Fanfare » d’Eran Kolirini où il est Haled, un jeune trompettiste de l’orchestre de la police d’Alexandrie, ou encore pour son rôle dans « La source des femmes » de Radu Mihaileanu) qui décrocha pour sa prestation le Valois du meilleur acteur au Festival international du film francophone d’Angoulême (FFA).
Le film ne fit l’objet d’aucun obstacle et d’aucune demande de modification ou de restriction. Il obtint l’avance sur recettes du Centre Cinématographique marocain (CCM) suite à l’étude du scénario ainsi que toutes les autorisations de tournage sollicitées (lesquelles furent peut-être facilitées par le fait qu’il n’y avait aucune scène explicite de sexualité frontale). À Cannes, sélectionné dans la section Un certain regard, il fut gratifié par le prix Fipresci de la Critique internationale (une première pour le Maroc). En août 2022, il reçut le Valois de la mise en scène au FFA et plus tard une multitude d’autres récompenses lors de plusieurs rencontres cinématographiques en Europe (il a été distribué dans une trentaine de pays dont en Amérique du Nord). Au Maroc, il fut également choisi parmi 15 longs métrages par une commission indépendante composée de professionnels de cinéma pour porter les couleurs du Royaume aux Oscars 2023 dans la catégorie du meilleur film étranger. Si « Adam » avait également été retenu pour concourir aux Oscars 2020 dans cette même section, « Le Bleu du caftan » présente la singularité d’avoir été sélectionné dans « la short-list », c’est-à-dire officiellement présélectionné pour concourir à la compétition (c’est la seconde fois après « Omar m’a tué » de Roschedy Zem en 2011 qu’un long métrage marocain intègre la short-list), mais sans avoir été nommé.
La sortie du film au Maroc fut différée à plusieurs reprises (initialement prévue le 22 février 2023, elle fut reportée en mars puis à nouveau en juin ; il aurait peut-être été délicat de programmer pendant le Ramadan, un film où l’homosexualité était évoquée). Il fut présenté le 4 juin 2023 en avant-première au Cinéma Atlas à Rabat en présence d’André Azoulay, conseiller du Roi. Le parti de la Justice et du Développement (PJD) demanda l’interdiction du film, dénonçant une œuvre qui fait « la promotion de l’homosexualité, en violation grave des constantes religieuses et nationales, et des valeurs morales et éducatives du peuple marocain musulman[59] ». Des allégations qui furent déjà avancées à propos de « Much Loved » et qui en général n’ont guère d’effets dissuasifs et constituent plutôt une incitation à découvrir l’œuvre réprouvée (« comme le fruit défendu, on veut le goûter[60] »).
L’audace du Bleu du catfan fut de montrer à l’écran un maître tailleur et son apprenti qui parviennent peu à peu à donner libre cours à leurs désirs (il s’agit d’un amour masculin profond et sincère dont d’aucuns au Maroc nient que de tels sentiments puissent exister) avec ce qui est inédit l’accord tacite de l’épouse du mâalem. Rares sont les films marocains qui intègrent dans leur récit des personnages homosexuels (dans « What Lola Wants » de Nabyl Ayouch, on note la présence de Youssef, un jeune égyptien gay qui vit à New York pour vivre comme il l’entend, mais c’est un personnage secondaire ; dans « Razzia », Inès, jeune fille tiraillée entre tradition et modernité est lesbienne. Quant à Hakim (fan de Queens et de Freddie Mercury) il apparaît comme un jeune homme à l’homosexualité suggérée peinant à trouver sa place dans la société. Dans « L’armée du Salut » d’Abdellah Taïa, adaptation à l’écran de son roman éponyme, est retracé le parcours d’un héros homosexuel (ce long métrage tourné au Maroc fut en compétition au Festival du film national de Tanger, mais ne fut pas distribué dans les salles du royaume).
Myriam Touzani n’a probablement pas tort lorsqu’elle affirme que son film pourra contribuer à faire évoluer les mentalités, mais encore faut-il qu’il soit visionné par un large public. Si les artistes ne peuvent pas sauver ou réparer le monde, ils sont en mesure d’apporter une voix essentielle, contribuant à travers leur art, à poser les bonnes questions, à semer le doute dans les esprits, à infléchir la posture des plus rétifs aux évolutions sociétales.
Patricia Caillé (dont les recherches portent sur les cinémas du Maghreb) souligne que les films en provenance du nord de l’Afrique sont essentiellement distribués en France et en Europe lorsqu’ils traitent de situation où les femmes sont opprimées moins quand elles sont émancipées[61]. Or un changement s’opère depuis quelques années avec par exemple « Papicha » de Mounia Meddour (César du meilleur premier film en 2020) ; « Un divan à Tunis » de Manele Labidi (où l’héroïne fait le choix de vivre seule, fume dans la rue). Mais on peut désormais également y intégrer les deux longs métrages de Maryam Touzani dont les personnages n’ont de cesse de chercher à s’extirper du carcan sociétal.
[1] Entretien avec la cinéaste marocaine, Maryam Touzani, https://cosmicmektoob.com, 25 mars 2023.
[2] « Maryam Touzani : un cinéma de la sensualité », Bienvenue au Club, www.radiofrance.fr, 22 mars 2023.
[3] Astrid Krivian, Nabyl Ayouch, « Au Maroc, il est difficile d’assumer sa différence », Afrique magazine, n°377, février 2018.
[4] Un professeur de hip-hop redonne de l’espoir à une catégorie de jeunes en mal de liberté face à l’endoctrinement religieux et aux traditions.
[5] Julien Vallet, Entretien avec Myriam Touzani, www.lebleudumiroir, non daté.
[6] Catherine Durand, Désirée de Lamarzelle, « Maryam Touzani, libre et transgressive comme l’héroïne de Razzia », www.marieclaire.fr, non daté.
[7] En réaction et en soutien à l’étudiante qui s’était vu refuser l’entrée dans une salle d’examen à l’université d’Alger, la réalisatrice algérienne, Sofia Djema, créa une page Facebook, « Ma dignité n’est pas dans la longueur de ma jupe ».
[8] Julien Vallet, op. cit.
[9] Catherine Durand, Désirée de Lamarzelle, op. cit.
[10] Entretien avec Maryam Touzani, https://ellimastorou.com/2018/04/25/razzia.
[11] Olivier Delcroix, « Notre critique du bleu du caftan », www.lefigaro.fr, 21 mars 2023.
[12] Eva Sauphie, « Le Bleu du Caftan, une ode à l’amour inconditionnel », www.jeuneafrique.com, 24 mars 2023.
[13] Salma Hamri, Entretien avec Maryam Touzani, www.maroc-hebdo.press.ma, 9 juin 2023.
[14] Ce film de 2000 est ressorti en salles en version remasterisée en 2023.
[15] Adaptation du roman de Mahi Binebine, Les Étoiles de Sidi Moumen.
[16] Patricia Caillé, Afriques en vision 2022 : table ronde, « La représentation des femmes dans les cinémas africains d’aujourd’hui », https://institutdesafriques.org, 3 décembre 2022.
[17] « Il est très difficile de convaincre les gens de faire un film avec des éléments fantastiques. Je me suis vraiment battue pour ça (…) Nous avons enfermé le cinéma arabe dans un pigeonnier : je veux lutter contre ces stéréotypes, je pense que le cinéma est surtout intéressant par sa richesse de langages » indique la cinéaste, (Lou Hupel, www.premiere.fr, 8 juillet 2023).
[18] Une représentation inédite des femmes avec Nasrim Erradi.
[19] L’Algérien Mohamed Lakhdar Hamina demeure jusqu’à présent le seul lauréat de la Palme d’or à ne pas être sélectionné comme membre ou président du jury à Cannes.
[20] Propos que tient Samia dans une conversation avec Alba dans le film.
[21] Née en 1989, Nisrin Erradi a participé, entre autres, ces dernières années à : « Les Ailes de l’amour » d’Abdelhai Larakil (2011) ; « Malak » d’Abdeslam Kelai (2012) ; elle était en lice pour le César du meilleur espoir féminin 2021 pour sa prestation dans « Adam ».
[22] La cinéaste dit avoir été séduite par l’impertinence de son regard, Pauline Maisterra, « Yasmine Benkiran, cinéaste et féministe », https://femmesdumaroc.com,15 mai 2023.
[23] Cette technique d’ornement des corps est condamnée par l’islam (le Prophète aurait dit « qu’Allah maudit celle qui tatoue, celle qui se fait tatouer) parce qu’elle dénature l’image que Dieu nous a donné ( Malek Chebel, Encyclopédie de l’amour en Islam, Petite bibliothèque Payot, Tome 2). Beaucoup de femmes le font enlever.
[24] Aïd al-Adha, cette grande fête musulmane commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour éprouver sa foi (il était prêt à sacrifier son fils).
[25] Jusqu’à dix années de prison pour les praticiens (article 453 du Code pénal).
[26] Association marocaine de lutte contre l’avortement.
[27] En septembre 2019, 490 personnalités (en référence à l’article 490 du code pénal) signèrent un manifeste pour dénoncer cette disposition.
[28] S’ils héritent de la mère, ils ne peuvent hériter du père biologique sans reconnaissance de l’enfant par celui-ci. Ils ne peuvent bénéficier de la couverture médicale du père ni des prestations sociales de la mère.
[29] Zaina Jnine, https//fr.hesspress.com, 22 octobre 2022.
[30] Zaina Jnine, https//fr.hespress.com, 5 novembre 2022.
[31] Ghalia Kadiri, www.lemonde, 27 septembre 2022.
[32] https://ellimastorou.com/2018/04/25/razzia.
[33] Soumaya Naamane Guessous, 360.fr, 7 novembre 2022.
[34] Cette spécialité est préparée à base de pâte de crêpe feuilletée et façonnée en fils très fins enroulés autour de la main et ensuite elle est aplatie et cuite avec un mélange de beurre et d’huile.
[35] Entretien avec Maryam Touzani, https://cosmicmektoob.com, 25 mars 2023.
[36] Propos issu du dossier de presse du film.
[37] Chloé Sarramèa, Numéro 05, Prostitution, avortement et cinéma : un couple marocain élève la voix, www.numero.com, 5 février 2020.
[38] Falila Gbadamassi, www.francetvinfo.fr, 5 février 2020.
[39] Lubna Azabal a une riche carrière derrière elle, la comédienne a tourné avec Nadir Moknèche (« Viva Laldjérie », « Goodbye Morocco », « Lola Pater », « L’Air de la mer rend libre ») ; André Téchiné (« Loin », « Les Temps qui changent ») ; Laila Marrakchi (« Rock the cabash ») ; Meryem Benm’Barek (« Sofia »).
[40] Thomas W, « Rencontre avec Lubna la plus internationale des actrices belges », www.metrotime.be, 8 février 2020.
[41] « Cinéma maghrébin des femmes au centre de l’écran », www.radiofrance, 4 février 2020.
[42] Thomas W, op. cit.
[43] La Sourate Al-Baqara (La Vache) indique qu’Adam a été créé par Dieu pour lui donner l’image la plus harmonieuse et relate l’histoire biblique d’Adam et Eve.
[44] Elle resta en détention durant un mois et demi et fut libérée après une grâce royale.
[45] www.komitid.com, 21 mars 2023.
[46] Christine Pinchart, « Le Bleu du caftan : une dentelle cinématographique noble », op. cit.
[47] Falila Gbadama, « Le Bleu du caftan : Maryam Touzani plonge dans les arcanes d’un amour », www.francetinfo.fr, 18/08/2022.
[48] Le Bleu du Caftan, www.rtbf, 29 mars 2023.
[49] Malek Chebel, Encyclopédie de l’amour en Islam, Petite bibliothèque payot, Tome 1.
[50] Olive Xavier, « Le Bleu du caftan : un film nécessaire pour ouvrir le débat sur l’homosexualité au Maroc », www.toutlecd.com, 25 mars 2023.
[51] Thomas W, op. cit.
[52] Le Bleu du caftan dévoile le tabou de l’homosexualité au Maroc, www.rfi, 18 mars 2023.
[53]Entretien radiophonique de Lubnal Azabal avec Christine Pinchart, « Le Bleu du Caftan : une dentelle cinématographique noble et délicate », www.rtbf.be,29 mars 2023.
[54] www.7sur7.Be/cinema/le-bleu-du caftan, 26 mai 2022.
[55] Anne Claire Gannac, « Myriam Touzani aborde les diverses facettes de l’amour », www.rts.ch, 29 mars 2023.
[56] Alexis Campion, « Lubna Azabal, une actrice d’amour et de guerre », www.lejdd.fr, 21 mars 2023.
[57] Sylvestre Sbille, « Lubna Azabal : je n’aime pas les donneurs de leçons », www.lecho.be, 24 mars 2023.
[58] Jenny Ulrich, interview minute de Myriam Touzani, www.bande-a-part, 23 mars 2023.
[59] Communiqué du secrétariat général du PJD, https://ledesk.ma, 19 juin 2023.
[60] Karim Boukhari, Le 360, 24 juin 2023.
[61] Patricia Caillé, Afrique en vision 2022/ La représentation des femmes dans les cinémas africains d’aujourd’hui, op. cit.